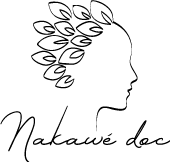Une enfant rebelle
Je suis née le 10 avril 1848 à Tilly dans l'Allier.
Mon père, Jean-Baptiste Auclert, est un riche fermier, maire républicain de la commune de Saint-Priest-en-Murat et farouche opposant de Louis-Napoléon Bonaparte.
Ma mère, Marie Catherine Joséphine Chanudet, malgré sept enfants, se consacre aux filles-mères qu'elle aide à trouver un emploi.
Mes deux parents me fournissent donc des modèles de résistance à l'ordre établi.
Malgré tout, issue de la bourgeoisie, je reçois l'éducation qui convient à mon milieu. Je suis donc scolarisée dans une pension religieuse.
Très jeune, je suis plutôt rebelle, me passionne pour la cause des plus démunis, et l'injustice me révolte. Je suis un élément perturbateur dans ce milieu voulu sage.
En 1861, mon père meure. En 1864, je vais vivre chez mon frère où habite ma mère. Mais deux ans plus tard, au décès de celle-ci, mon frère m'envoie dans un couvent que je quitte à ma majorité, fixée alors à vingt et un ans, au grand soulagement des sœurs.
L'héritage laissé par mon père et que je peux alors toucher me donne une indépendance économique, chose assez rare pour l'époque.
Des droits politiques pour les femmes
Toujours passionnée par la cause des plus faibles, je m'engage pendant la guerre de 1870 auprès des victimes de la variole.
Dans le journal L'Avenir des femmes, je découvre le combat de Léon Richer, journaliste libre-penseur et féministe, et de Maria Deraismes, femme de lettres, pour l'obtention de droits civils pour les femmes, comme le droit au divorce, de toucher son salaire.... Une déclaration de Victor Hugo, qui en est le président d'honneur, y est publiée en 1872 : « Dans notre législation, la femme est sans droits politiques ; elle ne vote pas, elle ne compte pas, elle n’est pas. Il y a des citoyens, il n’y a pas de citoyennes. C’est là un état violent : il faut qu’il cesse ».
Je m'installe alors à Paris et deviens secrétaire de ce journal.
Mais je veux aller plus loin en réclamant aussi des droits politiques, comme le droit de vote et l'éligibilité.
En 1876, je fonde la société le Droit des femmes, premier groupe suffragiste français, qui deviendra en 1883 Le Suffrage des femmes. Cette revendication d'une égalité politique entre les hommes et les femmes passe par des interventions publiques, des tribunes dans les journaux, des manifestations, des pétitions... Convaincue de la domination masculine, il me semble évident que les femmes doivent prendre en charge cette lutte.
Au printemps 1877, je lance un appel aux femmes de France : « Femmes de France, nous aussi nous avons des droits à revendiquer : il est temps de sortir de l'indifférence et de l'inertie pour réclamer contre les préjugés et les lois qui nous humilient. Unissons nos efforts, associons-nous ; l'exemple des prolétaires nous sollicite ; sachons nous émanciper comme eux ! »
Au premier Congrès international du droit des femmes, qui a lieu à Paris en 1878, le droit de vote n'est pas évoqué. Je n'ai donc pu y présenter mon discours jugé subversif, et dois donc le faire éditer. En voici un extrait :
« Trouvez-vous juste, messieurs, que les femmes subissent les lois sans les faire ; quelles soient mineures devant les droits, majeures devant les lois répressives ; qu’elles n’aient pas le droit de s’occuper de politique, et que, pour un écrit politique, elles soient condamnées à la prison et à l’amende... Trouvez-vous juste, messieurs, que les femmes n’aient pas le droit d’affirmer leur opinion par un vote, quand, pour avoir prêché les principes républicains, beaucoup ont été emprisonnées, exilées, déportées ? »
Déçue, je prends mes distances avec Léon Richer et Maria Deraismes.
Au Congrès ouvrier socialiste de Marseille de 1879, je prononce un discours sur l'égalité politique et sociale de la femme et de l'homme dont voici un extrait :
« Une République qui maintiendra les femmes dans une condition d’infériorité, ne pourra pas faire les hommes égaux. Avant que vous, hommes, vous conquériez le droit de vous élever jusqu’à vos maîtres, il vous est imposé le devoir d’élever vos esclaves, les femmes, jusqu’à vous... Les femmes ont à se défier de ceux qui prônent l'égalité de l'avenir et qui, dans le présent, s'opposent à ce qu'elles apportent leur intelligence, leurs idées, leurs goûts dans l'arrangement de cette société future. Femmes de France, je vous le dis du haut de cette tribune. Ceux qui nient notre égalité, dans le présent, la nieront dans l'avenir. Comptons donc sur nous-mêmes, n'abandonnons pas nos revendications. Nous sommes depuis des siècles trop victimes de la mauvaise foi, pour nous oublier nous-mêmes et croire qu'en travaillant pour le bien-être général, nous aurons notre part du bien général ».
En 1880, je tente de me faire inscrire sur les listes électorales en vertu de l'article 6 de la loi du 5 mai 1848 qui stipule que tous les français sont électeurs. « On m'a répondu que devant le scrutin « Français » ne signifiait pas « Française ». Si Français ne signifie pas Française devant le droit, Français ne peut signifier Française devant l'impôt ». (dans Le Vote des femmes, 1908)
Je décide alors de ne pas payer mon impôt puisque je n'ai pas le droit de vote : « Je laisse aux hommes qui s’arrogent le privilège de gouverner, d’ordonner, de s’attribuer les budgets, je laisse aux hommes le privilège de payer les impôts qu’ils votent et répartissent à leur gré. Puisque je n’ai pas le droit de contrôler l’emploi de mon argent, je ne veux plus en donner. Je ne veux pas être, par ma confiance, complice de la vaste exploitation que l’autocratie masculine se croit le droit d’exercer à l’égard des femmes. Je n’ai pas de droits, donc je n’ai pas de charges ; je ne vote pas, je ne paie pas. » (Lettre au préfet de la Seine, avril 1880).
Ma grève des impôts est très largement relayée dans la presse.
Mais je suis poursuivie et pour éviter les huissiers, je suis contrainte de les payer.
Un article dans La Presse du 13 août 1880 relate l'affaire et conclut en ces termes : « A nos yeux, comme aux yeux de la majorité, la femme a dans la société un autre rôle que celui que réclame Mlle Hubertine Auclert. Être l'ange du foyer, bien élever ses enfants, remplir ses devoirs de mère et d'épouse, c'est un rôle qui ne manque pas de dignité et qui doit lui suffire. »
Je fonde La Citoyenne dont le 1er numéro sort le 13 février 1881.
Au fil des publications, j'y dénonce sans relâche la soumission des femmes, j'y réclame leur affranchissement : « Le droit politique est le clou de notre émancipation : voilà pourquoi il rencontre une si grande hostilité parmi les hommes ; car, il faut bien le dire, la plupart des hommes, même les meilleurs, caressent l’idée généreuse de voir notre esclavage se prolonger encore un siècle ». (31 octobre-6 novembre 1881, n°38)
L'écrivaine libertaire Séverine, la sculptrice Maria Bashkirtseff soutiennent mon journal et y publient des articles.
En 1884, je dénonce la loi sur le mariage, très défavorable aux femmes, et propose la mise en place d'un contrat de mariage avec séparation de biens.
« Le mariage ne peut être éternellement, pour la femme la domestication gratuite et pour l’homme une exonération de dépenses et de travail ». (août 1884, n°87)
La féminisation de la langue
C'est un autre de mes combats qui m'a occupé toute ma vie car « L’omission du féminin dans le dictionnaire contribue, plus qu’on ne croit, à l’omission du féminin dans le code (côté des droits) ». (Le Radical, 18 avril 1898). Parce que l'effacement du féminin dans la langue masque les abus dont les femmes sont victimes.
« Quand on aura révisé le dictionnaire et féminisé la langue, chacun de ses mots sera, pour l'égoïsme mâle, un expressif rappel à l'ordre ». (Le Radical, 18 avril 1898)
Mais il ne s'agit pas seulement de féminiser les mots, je veux aussi faire entendre que les occupations réservées aux femmes ne leur appartiennent pas en propre et souligner le caractère arbitraire de la séparation des femmes et des hommes dans deux sphères distinctes. Je soutiens donc que les femmes doivent pouvoir exercer les mêmes fonctions que les hommes.
Mes années algériennes
En 1888, j'épouse Antonin Lévrier qui me soutient dans mes luttes. Juge de paix, il est envoyé en Algérie où nous nous y installons. Je confie le journal à Maria Martin, protestante d'origine anglaise qui consacre sa vie au féminisme, tout en continuant à y collaborer.
Et mon combat ne s'arrête pas, je deviens l'avocate des femmes arabes : je dénonce le mariage de jeunes filles avec des hommes mûrs, la polygamie, la répudiation et la non scolarisation des filles. En 1900 sera publié mon livre Les femmes arabes en Algérie.
En 1891, je demande au pape Léon XIII d'établir le dogme de l'égalité entre l'homme et la femme. Il faudra attendre le 15 juillet 1919 pour que le pape Benoît XV se prononce officiellement pour le vote des femmes.
En 1891, La Citoyenne cesse de paraître.
En 1892, mon mari meure et je reviens en France.
Le retour en France
Je collabore à plusieurs journaux comme Le Matin, La Fronde, La Libre Parole.. ainsi qu'au Radical où j'écris dans la rubrique « Le féminisme ».
J'organise aussi avec ma société Le Suffrage des femmes des réunions mensuelles à la mairie du 11ème arrondissement de Paris. Ces réunions sont des lieux d'information sur les droits des femmes, des lieux d'échanges et de propositions.
En 1889, je défends l'idée que les femmes n'ont pas à fêter ce que j'appelle le 89 masculin mais qu'elles ont à faire le 89 féminin.
« Il faut qu’elles mettent à profit les Congrès pour se concerter, s’entendre, organiser le mouvement féministe dans les départements en vue de poursuivre par tous les moyens l’émancipation de leur sexe ». (La Citoyenne, juin 1889, n°145)
En 1901, je fais fabriquer un timbre féministe représentant un homme et une femme déposant leur bulletin de vote dans une urne, timbre qui connaît un vif succès international.
En août 1904, je dénonce dans Le Radical le Code Napoléon qui est en « contradiction avec le régime actuel puisqu’il fait subsister une royauté, la royauté masculine, dans la famille et dans l’État ».
Le 29 octobre de cette même année, jour de commémoration du centenaire du Code Napoléon, qui fait de la femme une mineure à vie et une personne soumise inconditionnellement à son mari, j'organise une manifestation devant la chambre des députés pour revendiquer sa modification.
Grâce aux actions de féministes dont je fais partie, certains combats ont abouti : les vendeuses et les ouvrières obtiennent le droit de s’asseoir dans les grands magasins et les ateliers. En 1907, au conseil des prud’hommes, les femmes deviennent électrices puis éligibles. En 1908, les Françaises mariées obtiennent le contrôle de leurs propres salaires.
Je ne cesse de lutter pour l'obtention du droit de vote. Je publie Le Vote des femmes, et en 1908, rien ne changeant, je fais irruption à la mairie du 4ème arrondissement de Paris et renverse l'urne pour protester contre l’exclusion des femmes du suffrage « Ces urnes sont illégales ! elles ne contiennent que des bulletins de votes masculins ! alors que les femmes ont comme les hommes des intérêts à défendre à l’Hôtel de Ville ». Ce qui me vaut une arrestation.
Je me présente aux élections législatives du 24 avril 1910 dans la 2ème circonscription du 11ème arrondissement de Paris. Bien entendu ma candidature est rejetée.
Je me serai battue jusqu'à ma mort, survenue le 8 avril 1914, pour que les femmes obtiennent des droits politiques.
Mes œuvres
J'ai écrit de très nombreux articles, de nombreuses lettres et lancé plusieurs pétitions.
Les femmes arabes en Algérie. Paris, Société d'éditions littéraires, 1900.Le vote des femmes. Paris, V. Giard & F. Brière, 1908.
Les Femmes au gouvernail. Marcel Giard, 1925 (posthume).
Hubertine Auclert. Pionnière du Féminisme, textes choisis. Préface de Geneviève Fraisse, présentation de Steven C. Hause, Bleu autour, 2007.