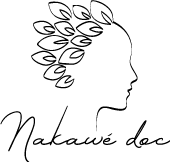Mon enfance
Je suis née le 22 avril 1766 à Paris.
Mon père, Jacques Necker, est un des principaux banquiers de Paris et se lancera en politique dès 1767. Ma mère, Suzanne Curchod, est fille d'un pasteur vaudois ce qui lui a permis de recevoir une bonne éducation. Ma mère tient un salon où sont reçus de nombreux écrivains : Diderot, d'Alembert, Helvétius, Marmontel... Ainsi que des hommes influents de l'époque. J'écoute beaucoup de conversations et assiste à de nombreuses pièces de théâtre. C'est ma mère qui gère mon éducation, mes plaisirs et mes devoirs sont tous des exercices de l'esprit. Dès ma première jeunesse, j'écris des portraits.
Mais ces leçons soutenues me fatiguent et à l'âge de 14 ans ma santé décline. Le médecin de famille ordonne l'abandon des études et la vie en plein air. Ma mère voit alors son plan renversé, son ambition pour moi et mes connaissances se voit anéanti. C'est la rupture et en même temps le rapprochement vers mon père.
En quête d'un mari
Ma dot est très conséquente, elle inspire donc de nombreux prétendants, tous rejetés par mes parents. Ils ont des exigences : mon mari doit appartenir à la religion réformée, et comme cette religion n'est pas reconnue en France, il ne peut être question d'un français. Mes parents ne voulant pas non plus se séparer de moi ni moi quitter Paris, mon futur mari doit y habiter.
Depuis que j'ai 12 ans, Erik-Magnus de Staël intrigue pour m'épouser. Dépensier sans retenue, il convoite ma dot comme les autres. À force de persévérance, d'interventions de Gustave III, roi de Suède, de la reine Marie-Antoinette et de Madame de Boufflers, favorite du roi Stanislas, et répondant à toutes les conditions de mes parents : Il est baron et ambassadeur de Suède en France, le contrat de mariage est signé le 6 janvier 1786. C'est donc un mariage de convenance plutôt que d'amour. Il n'y a pas d'entente entre nous, je donne toutefois naissance à une fille, Gustavine qui mourra en bas âge.
Du moins cette alliance me libère de ma mère et me permet d'ouvrir mon salon où je reçois : des écrivains, des savants, des philosophes, Lafayette, Noailles, Talleyrand...
À 20 ans, j'ai déjà écrit une pièce, 3 nouvelles et une tragédie.
J'admire Rousseau pour ses positions politiques et philosophiques, même si je suis blessée par ce qu'il dit des femmes. Je ne l'ai jamais rencontré mais je publie en 1788 un ouvrage qui en fait l'éloge Lettres sur les écrits de J.J. Rousseau. Cette publication me vaut une renommée littéraire.
Le temps de la Révolution
Je crois à la liberté, à l'instruction et je déplore le despotisme royal, l'injustice des privilèges, l'inégalité devant les impôts et l'impossibilité pour les femmes de s'exprimer dans les assemblées parlementaires.
Le 5 mai, j'assiste à l'ouverture des États Généraux.
Quand, dans la nuit du 11 juillet 1789, mon père, alors ministre et un des plus populaires, est renvoyé par le roi, nous partons nous exiler en Suisse, mon père y a une propriété à Coppet près de Genève. Je ne suis donc pas à Paris lors de la prise de la Bastille.
Devant la pression du peuple, le 20 juillet, mon père est rappelé, et je l'accompagne. Tout au long de la route qui nous mène à Paris, ce ne sont qu'acclamations et un véritable triomphe à l'arrivée.
J'ai 23 ans, la politique me passionne et je crois à la capacité de mon père de sauver la France. « Mon père a constamment supplié le roi d'accorder ce qu'il serait obligé de céder. C'est au système contraire qu'il faut attribuer l'arrogance du peuple et l'inconsidération du monarque et des grands, qu'on a vus de même tout refuser à la raison, tout abandonner à la violence. Si cet état durait, la France serait détruite, et sa dissolution serait terrible. Mais j'espère encore, que mon père l'a sauvera ». (Lettre à Gustave III, 16 août 1789).
Mon salon devient une succursale de l'Assemblée où on discute de ce qu'on voudrait voir adopter. Mon père déchu, les événements prennent une tournure qui ne me convient pas. Si au début de la Révolution, c'est l'exaltation et l'espoir d'une société plus juste et d'un progrès qui doit conduire à l'égalité, les jours s'assombrissent. Je condamne la cour, les Girondins pour leur maladresse, les Jacobins pour leur violence. En effet, les Jacobins ont pris le pouvoir à l'Assemblée, et pour moi, une assemblée unique cela revient à remplacer un despotisme par un autre. Je prône une monarchie représentative.
En 1790, Narbonne est mon amant. J'aurai deux fils avec lui : Auguste en 1790 et Albert en 1792. Je ne suis pas pour rien dans sa nomination comme ministre de la guerre, même si j'aurais préféré le voir au Ministère des Affaires étrangères, mais il en est renvoyé en mars 1792.
Le 20 avril 1792, à Paris, sur une proposition du roi Louis XVI, l'Assemblée législative déclare officiellement la guerre au roi de Bohême et de Hongrie, François II de Habsbourg, adversaire intransigeant du mouvement révolutionnaire en France. Car si Louis XVI a perdu ses privilèges de monarque absolu, il n'est pas sans pouvoir ; il possède le titre de représentant de la Nation et continue de nommer les ministres, les ambassadeurs, les chefs de l'armée, et s'il n'a plus le droit de guerre, l'Assemblée législative ne peut déclencher les hostilités que si le roi vient le lui demander. Et si l'Assemblée législative est favorable à la guerre, c'est dans l'espoir, entre autres, de propager la Révolution au reste de l'Europe.
Le 10 août, le peuple veut le détrônement du roi. Les insurgés, au nombre de 20000 marchent sur les Tuileries et s'affrontent aux Gardes suisses. Louis XVI et la famille royale sont arrêtés.
Le 2 septembre, ce sont les massacres des prisons. La panique des révolutionnaires, l'invasion de la France par la Prusse, la possibilité d'une répression par les royalistes, les divisions internes amènent des gardes nationaux et des civils à pénétrer dans les prisons où seront tués près de 1300 personnes, royalistes, prêtres et condamnés de droit commun.
Il est temps de s'enfuir, ce que je fais le 3 septembre. Je me réfugie au château de Coppet.
Je fais ce que je peux pour sauver des amis : évasions, faux papiers, passeurs.
Le 20 janvier 1793, je pars en Angleterre rejoindre Narbonne qui s'y était réfugié. C'est là que j'apprends la mort du roi.
Et lorsque la guerre éclate avec l'Angleterre, en février 1793, et que l'Europe entière se soulève contre la France, je ne vois plus que tyrannie, cruauté, folie.
Quelques mois plus tard, je reviens en Suisse, seule, Narbonne ne veut pas m'accompagner et ne me rejoindra jamais. De 1793 à 1794, j'essaie de sauver la vie des amis qui sont coupables d'aristocratie. Et je ne cesse d'écrire.
Je rentre à Paris en mai 1795, accompagnée de Benjamin Constant, nouvel amour avec qui j'aurai une fille, Albertine, en 1797, et dont la relation passionnée et tumultueuse durera de nombreuses années.
Je ne tarde pas à ouvrir de nouveau mon salon où très vite se presse la nouvelle élite.
Je publie Réflexions sur la paix intérieure, appel aux deux partis, républicains et royalistes, de s'unir dans le souci du bien commun. Appel similaire qu'avait fait quelques années plus tôt Olympe de Gouges avec son texte Les trois urnes, qui demandait le libre choix et qui lui valut la guillotine.
Très vite, je suis accusée d'être une protectrice des émigrés, de corrompre les députés qui viennent dîner chez moi, d'intriguer contre le nouveau gouvernement. Je dois me retirer hors de Paris, et le 15 octobre, par arrêté, j'ai dix jours pour quitter la France. Me voilà de nouveau à Coppet, où je suis surveillée de près, des rapports sur mes activités sont régulièrement rédigés. « En général, pour se maintenir dans le juste milieu, Madame de Staël reçoit tout le monde à Lausanne comme à Coppet. Chaque parti est admis indistinctement à toutes les heures chez elle ; les républicains s'y rencontrent avec les royalistes : les premiers n'y sont pas mal, mais les royalistes y sont mieux... Enfin, dit mon observateur, les premiers y dînent, mais les derniers y couchent ». (Desportes, résident de France à Genève, collecte les rapports).
Quelques jours avant Noël 1796, je m'introduis en France, accompagnée de Benjamin Constant. Nous nous installons à Hérivaux, domaine appartenant au père de B. Constant, à une trentaine de kilomètres de Paris, où je reste discrète tout en y recevant mes amis. Enceinte, je me décide à rentrer à Paris pour accoucher. Albertine naît le 8 juin 1797.
Très vite, je reprends la politique et veux à tout prix placer Talleyrand. J'y parviens en le faisant nommé ministre des Relations Extérieures, et mon salon retrouve le défilé quotidien de députés, hommes politiques, journalistes... J'envisage la formation d'un groupe républicain qui puisse se placer entre les royalistes et les Jacobins qui ne cherchent qu'à prendre le pouvoir. Le Directoire met un terme à cette crise dans la nuit du 3 au 4 septembre 1797 en faisant intervenir l'armée et arrêter les députés suspectés de royalisme. Ces derniers seront déportés, et de nouvelles mesures sont prises contre les prêtres réfractaires et les émigrés. Je reste encore à Paris pour essayer de sauver quelques amis et faire radier mon père de la liste des émigrés.
Début janvier, je retourne à Coppet et y vois le 28 janvier 1798 les troupes françaises envahir le pays de Vaud. Ce n'est que grâce à mon mari, le baron de Staël, nouvellement nommé ambassadeur extraordinaire de Suède auprès de la République française, que nous devons de ne pas être arrêtés et de ne pas voir nos biens confisqués.
Le traité d'annexion de Genève est ratifié en mai 1798, mon père et moi devenons français. Je peux donc rentrer en France librement, ce que je fais le 18 juin 1798.
Mon opposition à Bonaparte
Je rouvre mon salon où se discute la constitution de l'an III, constitution qui fonde le Directoire.
En 1798, j'écris Des circonstances actuelles pour terminer la Révolution où j'apparais en théoricienne politique et où je dénonce le danger militaire. « Il ne suffit pas de donner le commandement à ceux que le peuple repousse, il faut l'obliger à les choisir ; il ne suffit pas d'interdire la liberté de presse, il faut avoir 20 journaux qui dépravent tous les jours l'opinion et enflamment les haines ; il ne suffit pas de défendre la liberté des opinions dans les assemblées, il faut faire jouer une sorte d'opposition qui donne l'air d'un obstacle et permettre les excès du triomphe ».
Deux ans plus tard, je publie De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions. « Cet ouvrage va constituer le premier grand livre de ce siècle, celui qui relie le passé à l'avenir, les Lumières au Romantisme français, dans une parfaite harmonie... De la littérature se fonde sur la doctrine de perfectibilité, héritée de Condorcet qu'elle a connu et beaucoup admiré, de Turgot, de l'école d’Édimbourg, de Kant. Elle croit, comme eux, que la raison peut se perfectionner et l'humanité progresser indéfiniment ». (Simone Balayé. Madame de Staël. Femmes et Histoire, 1980). Et en ce début du 19ème siècle, je sais que la liberté est perdue.
Mon salon devient un lieu de critique et d'opposition à l'égard de Bonaparte et de sa politique. « Il me craint. C'est là ma jouissance, mon orgueil et ma terreur ».(Paul Gautier. Madame de Staël et Napoléon, 1902). De son côté, Bonaparte entame sa lutte contre la liberté de la presse : disparition des journaux qui ne sont pas en sa faveur, théâtre censuré, livres interdits. Et il va s'acharner contre moi. Déjà agacé par ce qui se dit dans mon salon, il va enrager à la publication de mon roman Delphine (1802). Ce livre remet en question la sainteté du mariage louée dans le Génie du Christianisme de Chateaubriand. Et dans mon roman, je ne cache pas ma désapprobation de mesures prises par Napoléon ; j'y fais l'apologie du protestantisme alors que le Premier consul a restauré la religion catholique ; j'y fais aussi un plaidoyer en faveur du divorce...
En 1803, Bonaparte m'invite à quitter Paris.
Mes voyages en Europe
À l'automne 1803, je pars donc en Allemagne où je me lie d'amitié avec Humboldt et Goethe.
En 1804, la mort de mon père me plonge dans un immense chagrin. J'écris alors un livre pour le célébrer Considérations sur la Révolution française.
Et je pars en Italie pour écrire Corinne, qui sera publié en 1807. Je vais à Turin, Milan, Rome, Naples, Florence et Venise. J'y rencontre gens de lettres et hommes politiques. Dans ce nouveau roman, j'évoque et loue l'Angleterre, et mon héroïne est poète, artiste et créatrice. Et comme je n'y mentionne pas une seule fois Napoléon, ni même ses victoires en Italie, il s'irrite encore contre moi.
Cependant, si mes ouvrages précédents m'acquièrent une renommée, celui-ci est un succès immense.
À mon retour en France où je suis devenue un des premiers écrivains français, je rédige De l'Allemagne, mon livre le plus critique. En plus de dépeindre le pays et ses habitants, je mets en lumière l'importance capitale de sa littérature et de sa philosophie. J'y fais une étude de Kant alors peu connu en France. En 1810, mon livre est prêt, Napoléon s'oppose à sa publication, il fait détruire le livre. Je sauve toutefois quelques manuscrits et publierais le livre à Londres en 1813 et à Paris en 1814 sous la Première Restauration.
Par l'intermédiaire de son ministre de la police, le duc de Rovigo, j'ai ordre de quitter la France. « Votre exil est une conséquence naturelle de la marche que vous suivez constamment depuis plusieurs années. Il m'a paru que l'air de ce pays ne vous convenait point, et nous n'en sommes pas encore réduits à chercher des modèles dans les peuples que vous admirez ». (Lettre du duc de Rovigo à Madame de Staël, 3 octobre 1810).
Dix ans d'exil
Je m'exile tout d'abord au château de Coppet où je suis sous surveillance, même certains de mes amis qui viennent me voir sont bannis de Paris. En 1811, je rencontre John Rocca, et en mai 1812, nous fuyons la Suisse avec ma fille et mon fils Auguste. À Vienne, je reçois mes passeports russes. Je traverse la Bohème, la Moravie, la Galicie, passe par Kiev et arrive à Moscou le 2 août où je ne reste que quelques jours avant de rejoindre Saint-Pétersbourg. Je suis le dernier écrivain occidental qui ait pu admirer la ville de Moscou qui allait être détruite par l'incendie provoqué par Napoléon. Je relate mon évasion et mes pérégrinations dans de Coppet à Stockholm.
Durant tout ce périple, ainsi que pendant les voyages précédemment faits en Allemagne et en Italie, partout ma renommée me devance. Dès que j'arrive quelque part, les gens se pressent pour me voir, pas un jour sans réception, que ce soit à l'hôtel où je me suis installée ou chez des hôtes, ou que je sois invitée. Mes Lettres sur J.J Rousseau avaient été traduites outre-Rhin dès 1789, Goethe a traduit mon Essai sur les fictions, et la plupart de mes ouvrages ont été traduits dans plusieurs langues, je suis donc très connue, contrairement à Chateaubriand par exemple que presque personne ne connaît.
Mais la Grande Armée de Napoléon progresse, je préfère partir pour Stockholm. C'est là que je publie Mes réflexions sur le suicide et continue la rédaction des Dix années d'exil. Je continue ma lutte contre Napoléon parce que c'est pour moi lutter contre le génie du mal et la tyrannie.
Je séjourne ensuite en Angleterre jusqu'en mai 1814.
Le retour en France
L'atmosphère ne me plaît pas, pas plus que le gouvernement en place. Je suis bouleversée par la présence des armées étrangères campant un peu partout dans Paris. Pourtant, mon salon ne désemplit pas, et je suis sans conteste une des célébrités les plus illustres, ce qui ne m'empêche pas d'écrire : « C'est un misérable esprit que celui de ce pays et depuis que j'y suis, je regrette l'idée que je m'en faisais quand j'étais exilée ». (Lettre à Sir James Mackintosh).
C'est un nouveau départ pour l'Italie, où je marie ma fille à Pise au duc de Broglie en février 1816. De retour à Coppet, c'est mon propre mariage avec John Rocca qui est célébré pour légitimer mon fils né dans le plus grand secret en 1812.
Nous nous installons de nouveau à Paris. Mais en février 1817, je subis une attaque qui me paralyse.
Je meurs le 14 juillet, laissant inachevés deux livres et des projets à peine entamés.
Mes oeuvres
Journal de Jeunesse, 1785.
Sophie ou les sentiments secrets, pièce en trois actes et en vers, 1786, publiée en 1790.
Jane Gray, tragédie en cinq actes et en vers, 1787, publiée en 1790
Lettres sur les ouvrages et le caractère de J.-J. Rousseau, 1788
Éloge de M. de Guibert, 1791
À quels signes peut-on reconnaître quelle est l'opinion de la majorité de la nation ?, 1791
Réflexions sur le procès de la Reine, 1793
Zulma, 1794
Réflexions sur la paix intérieure, 1795
Recueil de morceaux détachés comprenant : Épître au malheur ou Adèle et Édouard, Essai sur les fictions et trois nouvelles : Mirza ou lettre d'un voyageur, Adélaïde et Théodore et Histoire de Pauline, 1795
De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, 1796
Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et des principes qui doivent fonder la République en France, 1798
De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, 1800
Delphine, 1802
Épîtres sur Naples, 1804
Agar dans le désert, pièce de théâtre, 1806
Corinne, 1807
Geneviève de Brabant, pièce de théâtre, 1808
La Sunamite, pièce de théâtre, 1808
La Signora Fantastici, pièce de théâtre, 1809
Le Capitaine Kernadec ou sept années en un jour, comédie en deux actes et en prose, 1811
Le Mannequin, comédie, 1811
Sapho, pièce dramatique, 1811
De l'Allemagne, publié à Londres en 1813 et à Paris en 1814
Réflexions sur le suicide, 1813
De l'esprit des traductions, 1815
Considérations sur la Révolution française, 1818 (posthume)
Dix années d'exil, 1821 (posthume).
Œuvres complètes de Mme la Baronne de Staël, publiées par son fils, précédées d'une notice sur le caractère et les écrits de Mme de Staël, par Mme Necker de Saussure, 1820-1821