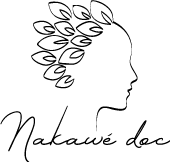Mon enfance
Mon père Don Mariano de Tristan est issu d'une des plus anciennes familles du Pérou. Son frère Don Pio de Tristan deviendra président de la République du Pérou. Ma mère, Thérèse Lainé, s'était réfugiée en Espagne à la Révolution. C'est là que mes parents se rencontrent avant de venir s'installer à Paris en 1802, où je nais le 7avril 1803.
Mon enfance est heureuse jusqu'à la mort brutale de mon père. Comme mes parents s'étaient mariés religieusement mais pas civilement, notre belle maison est confisquée à ma mère. Nous nous installons à la campagne, et après le décès de mon frère, nous revenons à Paris dans un quartier des plus pauvres.
À 17 ans, je travaille comme coloriste chez le peintre et lithographe André Chazal que ma mère m'oblige à épouser en 1821. Mais au bout de quatre années de mariage, avec un mari que je trouve vulgaire, médiocre, je quitte le domicile conjugal avec mes deux enfants et enceinte d'un troisième. Je ne peux divorcer puisque le divorce est aboli depuis 1816, je suis donc « hors de la société », paria, mais c'est là que j'aime l'idée qui guidera tout le reste de ma vie : l'affranchissement du prolétaire et celui de la femme.
Mon séjour au Pérou
En 1825, je confie mes 3 enfants à ma mère pour pouvoir travailler. Je suis ouvrière coloriste, chez un confiseur, femme de chambre dans une famille anglaise ce qui me permet de séjourner en Angleterre. N'ayant pas reçu d'éducation, je profite de ces années pour m'éduquer. Je reste en Angleterre jusqu'en 1831.
A mon retour en France, harcelée par mon mari malgré la séparation des biens faite en 1828, je change d'identité, m'appelle désormais Flora Tristan di Moscoso, et je pars pour le Pérou, voir mon oncle et réclamer ma part d'héritage, ce qu'il me refusera. Il m'accordera toutefois une pension qui me mettra à l'abri financièrement.
Durant mon séjour au Pérou, j'observe la vie sociale, politique, le pouvoir de l'église, les injustices, l'esclavage. Autant de faits que je relate dans Pérégrinations d'une paria.
« Nul autre homme que l'Indien des Cordillières n'aurait assez de patience, de douceur pour utiliser les llamas. C'est sans doute cet extraordinaire compagnon, donné par la Providence à l'indigène du Pérou, qu'il a appris à mourir quand on exige de lui plus qu'il ne veut faire. Cette force morale, qui nous fait échapper à l'oppression par la mort, si rare dans notre espèce, est très commune parmi les Indiens du Pérou, ainsi que j'aurai souvent l'occasion de le remarquer ».
En 1934, je rentre en France.
Années difficiles
Mon mari, ne supportant toujours pas notre séparation, ne cesse de me poursuivre. Malgré de nombreux déménagements pour lui échapper, il réussit tout de même par deux fois à enlever ma plus jeune fille. Tout d'abord en octobre 1835, ce qui m'oblige à mettre ma fille en pension et à m'exiler en Angleterre où je travaille comme dame de compagnie quelques mois avant de revenir à Paris. En juillet 1836, nouvel enlèvement. En avril 1837, ma fille s'échappe et accuse son père de tentatives incestueuses. Un non-lieu est prononcé, faute de preuves. En mars 1838, la séparation de corps est prononcée aux torts de mon mari, ce qui a pour conséquence de redoubler sa colère et le 10 septembre il tire sur moi en pleine rue. La balle s'est logée sous le cœur.
C'est à ce moment-là que j'adresse à la Chambre des députés une pétition demandant l'abolition de la peine de mort.
En février 1839, mon mari est condamné à 20 ans de prison.
Ces malheureux événements m'ont rendu populaire et mes Pérégrinations d'une paria se vendent très bien. Il faudra même une troisième édition. Mon roman Méphis publié en 1838 connaît aussi le succès. Mes ouvrages littéraires m'ouvrent les portes du monde des gens de lettres et des artistes. Malgré quelques distractions, je reste taraudée par les questions sociales. Je m'intéresse aux théories, de Saint-Simon, de Fourier, d'Owen, mais j'ai besoin d'action.
Je me sens investie d'une mission divine : pour tout individu, le droit au travail et en vue du bien-être de tous et de toutes, l'organisation du travail. Avec l'idée nouvelle que ce soit le peuple lui-même qui s'organise.
La question sociale
L'intérêt passionné que je porte pour la question sociale provient autant de mes lectures que de mes observations personnelles.
Je pars en Angleterre analyser son système social et le nouveau monde industriel. En 1840, je publie Promenade dans Londres où je relate la condition ouvrière, la condition féminine, l'éducation, la criminalité... Pour moi, Londres constitue le lieu de « tous les parias qui couvrent comme d'une lèpre cette immense ville, dont le luxe est si scandaleux, la misère si affreuse !... L'Angleterre retentit en tous lieux de cris de révolte et de destruction. Oh ! Lords, repentez-vous, redoutez la vengeance du peuple ».
Ce que je mets alors en évidence, c'est la notion de lutte des classes comme principe caractéristiques de la Révolution moderne.
« La grande lutte, celle qui est appelée à transformer l'organisation sociale c'est la lutte engagée, d'une part entre les propriétaires et capitaliste qui réunissent tout, richesse, pouvoir politique, et au profit duquel le pays est gouverné, et, d'autre part, les ouvriers des villes et des campagnes qui n'ont rien, ni terres, ni capitaux, ni pouvoirs politiques, qui payent cependant les deux tiers des taxes, fournisseur les recrues de l'armée et de la flotte, et que les riches affament, selon leur convenance, afin de les faire travailler à meilleur marché ».
Ce livre est de nouveau un succès et dans le salon que je tiens rue du Bac défilent philosophes, gens de lettres, ouvriers.
Je n'ai plus qu'une idée : l'auto-émancipation ouvrière.
L'union ouvrière
Mon idée est de permettre la cohésion de la classe des ouvriers et ouvrières jusque là divisée selon les métiers.L'objectif est donc la constitution d'une classe ouvrière. Mais aussi, de faire représenter la classe ouvrière devant la nation, de faire reconnaître la légitimité de la propriété des bras, d'élever dans chaque département des palais de l'Union ouvrière pour y instruire les enfants de la classe ouvrière, y accueillir les ouvriers et ouvrières blessés au travail, ainsi que les prolétaires infirmes ou vieux.
Pour cela, j'écris l'Union ouvrière, que je publie en juin 1840 grâce à des souscriptions, notamment de Victor Considérant, George Sand, Eugène Sue, Marceline Desbordes-Valmore, Louis Blanc. Je l'envoie à toutes les sociétés de compagnonnage, accompagné d'une lettre : « C'est donc uniquement au point de vue général que j'ai traitée la question de l'Union entre tous les ouvriers. Pour moi, il n'y a ni gavots (membre de l'association de compagnonnage le Devoir de liberté) , ni dévoirants (compagnon du devoir), mais seulement des hommes égaux, des citoyens ayant les mêmes droits et les mêmes intérêts, des frères malheureux devant s'unir pour réclamer pacifiquement leurs droits et défendre leurs intérêts ».
Très vite, je reçois des invitations de toutes les villes pour venir présenter le livre. Je me rends à Bordeaux le 15 septembre 1843. L'expérience est riche et l'idée de faire le tour de France des compagnons se fait jour.
Dans la 2e édition, je rédige un appel adressé aux femmes en particulier et j'y expose mes idées féministes, parce que les progrès de la civilisation dépendent non seulement de l'Union ouvrière mais aussi de l'instruction et de l'émancipation des femmes.
« Jusqu'à présent, la femme n'a compté pour rien dans les sociétés humaines... L'église ayant dit que la femme était le péché; le législateur, que par elle-même elle n'était rien, quelle ne devait jouir d'aucun droit; le savon philosophe, que par son organisation elle n'avait pas d'intelligence, on en a conclu que c'était un pauvre être déshérité de Dieu, et les hommes et la société l'ont traitée en conséquence... L'infériorité de la femme une fois proclamée et posée comme principe, voyez quelles conséquences désastreuses il en résulte pour le bien-être de tous et de toutes en l'humanité... Je voudrais qu'elle fût placée dans la société sur un pied d'égalité absolue avec l'homme ».
À l'époque, le combat pour les droits des femmes se bornent à l'égalité des conjoints dans le mariage et à l'accession des femmes aux carrières libérales. Je suis plus audacieuse, et réclame un salaire égal, le droit à leur indépendance par le travail, leur indépendance physique et moral par rapport à l'homme, leur droit à l'éducation, intellectuelle et professionnelle.
Parce que je suis convaincue que « L'oubli et le mépris qu'on a fait des droits naturels de la femme sont les seules causes des malheurs du monde ».
Le 12 avril 1844, j'entame mon tour de France.
Tour de France
Je rejoins Auxerre en bateau, et suis l'itinéraire habituel du compagnonnage : Dijon, Châlon, Saint-Étienne, Mâcon, Lyon, étape centrale de mon parcours. J'y arrive le 30 avril 1844, déjà épuisée par les premières étapes où je ne cesse, du matin au soir, de me mêler aux réunions des travailleurs, de présenter et distribuer mon livre. De nouvelles éditions sont publiées, cette fois grâce aux souscriptions spontanées des ouvriers eux-mêmes, comme à Lyon où, durant la séance que j'anime, est recueillie une somme permettant de pouvoir en imprimer 4000 exemplaires.Je crée un comité ouvrier et je repars le 7 juillet 1844 encore plus épuisée et malade.
À Marseille, le 11 août, je fonde un cercle de l'Union ouvrière : « Je sortis de là animée par le bonheur, je ne pus dormir de la nuit, et le lendemain, j'étais brisée, tuée... ». (Notes devant servir à mon ouvrage le Tour de France).
Malgré la maladie qui empire, je continue mon voyage, avec toujours cet accueil chaleureux et enthousiaste des ouvriers, et la police aussi toujours présente pour m'empêcher d'agir en interdisant tout réunion.
J'arrive à Bordeaux où je meurs le 26 septembre 1844 de la fièvre typhoïde, j'ai 41 ans.
Je me suis engagée jusqu'au sacrifice de ma vie dans la lutte révolutionnaire socialiste, mais proclamant que l'auto-émancipation du prolétariat et la libération des femmes devaient s'accomplir dans le même mouvement, mes idées et mon œuvre ont été rejetées après ma mort aussi bien par les mouvements socialistes que par les historiens.
Après ma mort, une souscription est ouverte par des ouvriers de Bordeaux pour ériger un monument pour honorer ma mémoire. Ce monument se trouve au cimetière de la Chartreuse à Bordeaux.

A la mémoire
De Mme Flora Tristan
Auteur de l'Union Ouvrière
Les travailleurs reconnaissants
Liberté . Égalité . Fraternité
Mes œuvres
Nécessité de faire un bon accueil aux femmes étrangères, 1835
Pérégrinations d'une paria (1833-1834), 1837
Méphis, roman, 1838
Promenades dans Londres, 1840
L’Union ouvrière, 1843
L’Émancipation de la Femme ou Le Testament de la Paria, publié à titre posthume, 1846
Le Tour de France. Journal 1843-44, publié à titre posthume, 1973